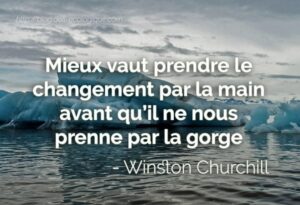
La crise géopolitique actuelle, les incertitudes économiques et l’inflation alimentent la peur de l’avenir immédiat : on se demande si on pourra garder son emploi, remplir son frigo, payer ses factures.
Dans ce contexte, la transition écologique commence à apparaître comme un “luxe” ou une injonction lointaine, incomprise et parfois carrément rejetée.
Pourtant, la transition n’est pas seulement une question de climat dans 20 ou 50 ans : c’est aussi une réponse structurelle aux risques économiques, sociaux et budgétaires d’aujourd’hui. Elle peut devenir un levier concret pour garantir la stabilité économique, la cohésion sociale et la résilience face aux bouleversements climatiques et aux incertitudes qui ne cessent de se multiplier.
Mais il convient d’agir rapidement pour se prémunir contre des risques majeurs (écologiques, financiers, sociaux) tout en libérant des opportunités de création de valeur et d’emploi.
LES CONSEQUENCES DE L’INACTION
Ne pas agir aujourd’hui, c’est exposer dès aujourd’hui ses vulnérabilités à des aléas qui seront de moins en moins maitrisables et finançables :
- Pour les collectivités : Dégradation des infrastructures, augmentation des coûts liés aux catastrophes naturelles, déficit d’attractivité et perte de confiance des citoyens. Les collectivités sont directement impactées par les effets du changement climatique sur leur territoire, avec pour conséquence des fractures et des inégalités croissantes
- Pour les entreprises : Risques accrus liés aux événements climatiques extrêmes, perte de compétitivité, difficultés d’approvisionnement, perte de valeur des actifs, et perte de parts de marchés. Une évolution non maîtrisée du changement climatique aurait des conséquences négatives considérables.
- Pour les ménages : Augmentation des coûts liés aux catastrophes naturelles, hausse des prix de l’énergie et des biens de consommation, difficultés d’accès aux services essentiels, et perte de pouvoir d’achat. Le changement climatique aura des effets sur la santé des populations. L’inaction engendrerait des pertes de productivité.
PARMI LES AVANTAGES D’UNE ACTION RAPIDE
- Pour les collectivités
· Stabilisation budgétaire : Les politiques de prévention (rénovation, gestion économe de l’eau, solutions naturelles) coûtent souvent moins cher que la réparation des dégâts.
· Renforcement de la cohésion territoriale : Des projets écologiques (relocalisation d’activités, circuits courts, énergies renouvelables) peuvent doper l’emploi local et l’attractivité du territoire. Ils contribuent à une meilleure justice sociale.
· Anticipation des risques: Être en avance sur les normes environnementales (zones à faibles émissions, infrastructures résilientes) offre une meilleure adaptabilité face aux chocs géopolitiques et climatiques.
- Pour les entreprises
· Compétitivité accrue : L’innovation verte (économies de ressources, nouveaux procédés, éco-conception) réduit les coûts sur le long terme (énergie, matières premières) et confère un avantage d’image et de marché (croissance des demandes bas-carbone).
· Souveraineté industrielle : Miser sur des filières renouvelables, la transition agricole ou l’économie circulaire renforce l’autonomie vis-à-vis des fluctuations du marché mondial.
· Résilience financière : Les entreprises plus sobres en énergie et en ressources sont moins vulnérables aux hausses de prix ou aux ruptures d’approvisionnement liées aux tensions géopolitiques.
- Pour les ménages
· Réduction des dépenses courantes : Des logements mieux isolés et un usage plus rationnel de l’énergie ou des mobilités partagées allégeront la facture énergétique, dès les premiers travaux.
· Qualité de vie : La réduction de la pollution de l’air, la restauration d’espaces naturels, la production alimentaire locale sont autant de bénéfices concrets pour la santé et le bien-être.
· Opportunités d’emplois : Les métiers verts (rénovation, énergies renouvelables, éco-conception) offrent des postes de techniciens, d’ingénieurs, de formateurs, ce qui renforce l’employabilité et la requalification professionnelle.
LA TRANSITION ECOLOGIQUE, UN NOUVEAU LEVIER
Loin de n’être qu’une vision idéaliste pour 2050, la transition écologique s’impose comme un élément de réponse stratégique aux problèmes quotidiens de nos territoires, de nos entreprises et de nos ménages. Sur le court terme, elle atténue l’impact des chocs d’approvisionnement et fait baisser les factures énergétiques. À moyen terme, elle soutient la compétitivité des filières locales, crée des emplois et réduit la vulnérabilité aux aléas climatiques. Sur le long terme, elle limite les risques irréversibles pesant sur notre société et notre économie, tout en assurant la préservation de l’environnement pour les générations futures.
Dans un contexte géopolitique de plus en plus instable, cette démarche n’est donc pas un “luxe” mais un levier de souveraineté et de résilience. En reliant les objectifs écologiques, économiques et sociaux, la transition écologique offre une voie de développement vertueuse : elle protège le pouvoir d’achat, renforce l’emploi local et garantit une meilleure sécurité énergétique. C’est pourquoi, pour les collectivités, les entreprises comme pour les ménages, agir vite est autant un impératif moral qu’un choix rationnel.
Mais tout n’est pas si simple…
VERS UNE TRANSITION VERTE.. ET JUSTE
Tout d’abord, tous les territoires et toutes les populations sur chaque territoire ne sont pas impactés de la même façon par des évènements climatiques extrêmes. Ensuite, les politiques «bas carbone » peuvent favoriser certaines catégories sociales ou géographiques, MAIS fragiliser un peu plus certaines autres (diesel et ruralité par exemple.). Le potentiel de la transition pour créer de l’emploi notamment dans les filières vertes peut offrir des opportunités d’insertion, MAIS nécessite d’anticiper la reconversion des secteurs en déclin.
De même, si le renforcement de la résilience locale passe par la mise en place d’infrastructures adaptatives (réseaux d’eau résilients, bâtiment bioclimatiques, énergies locales…), il nécessite une capacité financière et technique que toutes les collectivités n’ont pas.
Une transition JUSTE doit réduire les inégalités (emplois, économies d’énergie, qualité de vie) et sécuriser le budget des collectivités (baisse des dépenses, attractivité). Le rôle de ces dernières est, une fois de plus, central car c’est au niveau territorial que l’on aura l’expertise locale et la proximité avec les habitants qui permettront de percevoir directement les retombées positives et les blocages de la transition écologique.
Pour les y aider, les nouvelles technologies (IA, datas, jumeau numérique…) offrent des outils performants pour simuler, planifier et améliorer la gestion des ressources, sous réserve de respecter le budget, l’environnement et les libertés (souveraineté des données, protection de la vie privée).
CONCLUSION
L’urgence de la transition écologique s’inscrit dans un cadre plus large, où les enjeux de justice sociale ne peuvent être considérés comme secondaires. Sans dispositifs équitables de redistribution et d’accompagnement, le risque est réel de voir les fractures sociales se creuser davantage. Inversement, une transition conçue dans une logique de solidarité peut consolider la cohésion territoriale, prévenir certaines tensions géopolitiques (par la sécurisation énergétique) et amplifier l’innovation économique.
Pour concrétiser ce cercle vertueux, il est indispensable de :
- S’assurer que les nouvelles politiques climatiques n’aggravent pas les inégalités,
- Soutenir les collectivités et les acteurs de terrain par des mécanismes d’ingénierie et de financement,
- Renforcer la participation citoyenne,
- Intégrer la question de la dépendance aux matières premières critiques dans une vision internationale,
- Garder à l’esprit l’exigence d’une action rapide pour prévenir les dommages et points de non-retour annoncés par les scientifiques.
La transition écologique, lorsqu’elle est pensée comme une opportunité de justice et de transformation sociale, peut véritablement devenir le socle d’un nouveau modèle de développement, à la fois soutenable et inclusif.
CAMBIUM STRATEGIE peut vous accompagner dans cette démarche, par la définition et la mise en œuvre des étapes suivantes :
– Diagnostic territorial croisé (Environnement/ Economie/Social)
-Co construction de plans d’action « Transition et inclusion »
-Pilotage et suivi d’impact (social, environnemental, économique) pour évaluation et ajustement
-Outils de communication et de valorisation (interne/externe)
Contactez-nous pour plus de détail et de références.
